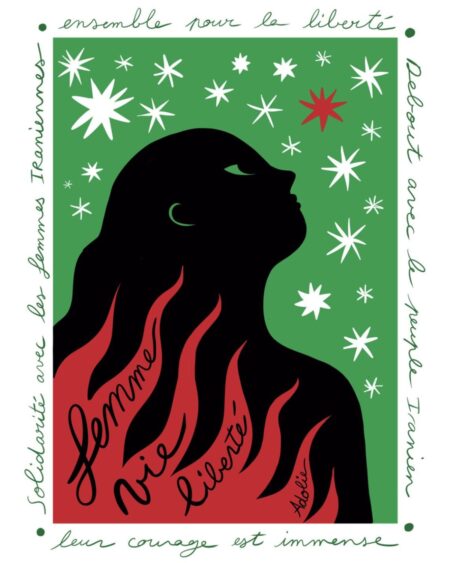Entre 50 % et 80 % des images pédopornographiques retrouvées sur certains sites ou bases de données illégales proviennent à l’origine de contenus partagés par les parents eux-mêmes sur les réseaux sociaux. C’est le constat de récentes études qui font froid dans le dos car qui n’a jamais vu passer sur son feed Instagram des photos de bébés d’amis venant de naître ou d’adorables frimousses en vacances ? Personne. Car c’est une habitude ancré dans le quotidien de nombreux parents : partager sur leurs réseaux sociaux des photos de leur progéniture, l’occasion de donner des nouvelles, partager leur bonheur familial ou les dernières frasques du petit dernier rebelle ! Oui mais voilà, ce qu’on appelle aujourd’hui le « sharenting » est une pratique potentiellement dangereuse pour nos enfants. Pour mieux le comprendre, j’ai interrogé Eglantine Cami, chargée de sensibilisation et de plaidoyer au sein de l’association Caméléon qui agit pour éradiquer les violences sexuelles envers les enfants et les adolescents à travers des programmes d’accompagnement, de sensibilisation et de plaidoyer.
crédit photo de couverture – Charlein Gracia
Eglantine Cami, vous êtes chargée de sensibilisation et de plaidoyer au sein de l’association Caméléon : qu’est-ce que le sharenting ?
Publier une photo ou une vidéo sur Internet est devenu aujourd’hui un geste totalement ordinaire, et même inscrit dans le quotidien de certains parents. On partage les moments du quotidien pour le plus grand bonheur de nos proches (ou moins proche dans le cas des profils publics) : c’est ce que l’on appelle le sharenting, un mot-valise issu de la contraction des mots anglais « sharing » (partager) et « parenting » (éducation parentale).
Avant l’âge de 13 ans, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photos diffusées par son entourage proche en ligne.
Rapport de 2018 du bureau du commissaire à l’enfance du Royaume-Uni
Mais cette pratique n’est pas sans risques.
En y donnant accès, on divulgue en fait bien plus. Il est facile de reconnaître les enfants, d’en apprendre davantage sur leurs habitudes ou leurs loisirs. Nous pouvons même parfois trouver le nom de leur école, de leur club sportif, ou du parc où ils se retrouvent entre amis les mercredis après-midi. Nous ne donnerions pas ces informations à des inconnus dans la rue… alors pourquoi le ferions-nous en ligne ?
Cela a d’ailleurs été le thème de notre dernière campagne de sensibilisation.
Vous sensibilisez les parents pour les inviter à ne pas (ou peu et sous certaines conditions) partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. En cause : plus de 50% des contenus des forums pédocriminiels sont auto-produits, c’est-à-dire que ces photos ont été publiées par les parents, l’entourage proche ou l’enfant lui-même.
Les pédocriminels se servent en masse sur les réseaux sociaux ?
Effectivement ce chiffre date de 2022 et en réalité on ne sait pas s’il est toujours d’actualité car aujourd’hui il y a un nouvel enjeu de taille avec l’intelligence artificielle et la génération de contenus pédocriminels. Mais ce que l’on peut noter c’est qu’effectivement, une grande partie des contenus qui se retrouvent sur les réseaux pédocriminels proviennent des comptes des parents ou de l’entourage de l’enfant.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il s’agit de photos anodines : d’enfants qui jouent, se promènent, mangent une glace, des simples photos de classe…
Ces images sont usurpées à l’insu des parents pour se retrouver sur des forums pédocriminels.
Certains parents adeptes du sharenting pensent ne pas mettre en danger leur enfant en postant une photo d’eux au carnaval par exemple. Ils se trompent ?
Oui, une photo totalement anodine peut répondre à un fantasme d’un pédocriminel et être interprétée de façon sexualisante comme un enfant qui lèche une glace, ou encore prend son bain… ou même un enfant qui mange, sort d’un club de sport…
Je donne souvent un exemple tiré d’un forum du darknet : un pédocriminel avait partagé une photo de colonie de vacances avec tous les enfants bien habillés et en rangées. Pourtant les prédateurs débattaient sur quelle petite fille était la plus sexy et ce qu’ils aimeraient lui faire… C’est inimaginable.
Vous évoquez l’intelligence artificielle : en quoi représente-t-elle un nouveau risque pour nos enfants ?
Gabrielle Hazan, cheffe de l’OFMIN (l’office central dédié à la lutte contre les violences commises à l’encontre des mineurs créé en 2023) expliquait récemment au micro de Radio France que :
On estime que, dans quelques années, 95% des images pédocriminelles seront issues de l’Intelligence Artificielle.
Gabrielle Hazan, cheffe de l’OFMIN
D’après une étude publiée en 2024 par Europol, le volume de contenus pédocriminels générés par l’IA ne cesse d’augmenter. Il peut s’agir : de vidéos pornographiques où visages et corps sont artificiellement rajeunis, de photos anodines d’enfants que la technologie dénude ou encore de nouveaux contenus créés à partir d’anciennes victimes (deepfakes). Bien que ces contenus soient artificiels, les violences qu’ils représentent et leurs conséquences sont, elles, bien réelles.
D’après l’Internet Watch Foundation (IWF), entre le 1er janvier et le 30 juin 2025, ont été recensées 210 pages web contenant des images pédopornographiques générées par IA : soit +400 % par rapport à la même période en 2024.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’IA offre la possibilité aux criminels sans grandes compétences techniques de créer ces contenus pédocriminels, c’est tout l’effet pervers de ces IA régénératives. Il manque un cadre juridique clair, une régulation stricte fondée sur les droits de l’enfant.
Comment conseillez-vous de légiférer sur ces questions d’IA et de pédocriminalité ?
Alors c’est très difficile de faire entendre sa voix : comme avec toutes les nouvelles technologies, il est question d’innovation, de vie privée des utilisateurs… Mais il y a aussi une responsabilité des fondateurs et des créateurs de ces nouvelles technologies : elles ne doivent pas êtres utilisées à des fins illégales.
La sécurité en ligne doit être prise en compte dès le début de la création de cette technologie. Heureusement, nous ne sommes pas seuls à porter un projet de législation. La fondation pour l’enfance a publié un rapport en octobre 2024 avec toute une série de recommandations comme la modification du Code pénal pour incriminer la création, la diffusion et le simple fait de posséder des contenus à caractère sexuel générés par IA montrant des mineurs (deepfakes, images synthétiques…) même sans victime réelle.
La législation actuelle nous aide dans ce combat : on peut sanctionner des contenus pédocriminels générés par l’IA car ce qui est interdit, c’est de détenir des contenus à caractère sexuel représentant notamment un mineur, donc même un dessin de viol sur mineur est considéré comme pédocriminel et donc répréhensible.
Le sujet est sur la table et les discussions sont ouvertes.
Dans votre travail de sensibilisation des parents, vous évoquez le sujet de l’identité numérique et des droits de l’enfance : de quoi s’agit-il concrètement ?
Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il faut savoir qu’en 2023, 53% des parents français avaient déjà partagé une photo de leur enfant en ligne et 43% d’entre eux dès la naissance.
Se pose la question du sharenting. On essaie de sensibiliser les parents à deux niveaux : le premier, sur la question de la récupération illégale de ces photos sur des forums du darknet évoquée plus haut (et tous les risques sur la sécurité de l’enfant que cela implique), et le second sur la question du droit à la vie privée des enfants.
En 2023, le député Bruno Studer avait porté une proposition de loi adoptée définitivement en février 2024, concernant la protection de la vie privée et du droit à l’image des enfants dans l’environnement numérique : le texte inscrit explicitement la notion de vie privée de l’enfant dans l’article 372‑1 du Code civil, aux côtés de la sécurité, de la santé et de la moralité. Les parents doivent protéger ce droit au même titre que les autres aspects du bien‑être de l’enfant. Cela signifie notamment que le droit de publier ou diffuser l’image d’un enfant doit être exercé en commun par les deux titulaires de l’autorité parentale, et la loi précise qu’il est également recommandé d’associer l’enfant à cette décision, en fonction de son âge et de sa maturité.
Bien sûr notre action de sensibilisation se fait aussi auprès des enfants eux-mêmes, entre 6 et 18 ans. On travaille sur les violences en générale (comment développer des moyens d’auto protection par exemple) et sur les violences en ligne qui évoluent rapidement. Une de nos méthodes est notamment de faire le parallèle entre le « en ligne » et le « hors ligne ». Si tu croises un adulte dans la rue demain qui demande des photos de toi, est-ce que tu lui donnes ? Maintenant est-ce que tu ferais pareil si c’était en ligne ?
On sensibilise également au grooming : cette technique des pédocriminels qui consiste à se faire passer pour un jeune en ligne. Quand on questionne les enfants pour leur demander « Mais comment tu es sûr qu’il s’agit bien d’un enfant de ton âge ? », les enfants répondent « Je demande sa pointure de chaussure, ou je regarde s’il a les mêmes expressions que moi, s’il fait des fautes de français ». On doit leur expliquer que ce n’est pas suffisant. Malheureusement les pédocriminels ont des techniques de prédation et de manipulation rôdées, d’autant qu’ils n’agissent jamais seuls : ils s’entraident entre eux sur des forums où ils se donnent des conseils pour mieux manipuler un enfant, l’agresser sans laisser de trace…
Quel est le réseau social le plus touché par la pédocriminalité ?
Le réseau social le plus utilisé par les pédophiles est Instagram : que ce soit pour chercher du contenu ou approcher des enfants.
Eglantine cami, association caméléon
Ensuite quand un prédateur rentre en contact avec un enfant pour échanger du contenu, cela se passe le plus souvent sur Whatsapp ou Télégram.
Notre objectif n’est pas de culpabiliser les parents : la culpabilité revient aux pédocriminels mais la responsabilité de protéger les enfants est collective.
Eglantine cami, association caméléon
Quels conseils partagez-vous aux parents qui souhaitent partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr qu’on a envie de dire aux parents de ne partager aucune photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux mais c’est difficilement acceptable pour des parents qui ne sont pas encore assez sensibilisés.
On les invite à prendre des précautions :
1. Limiter la diffusion : en premier lieu, évitez de publier ces contenus en accès public. Privilégiez un cercle fermé — uniquement famille et proches de confiance. Activez des paramètres de confidentialité stricts, et n’oubliez jamais que tout peut être capturé (capture d’écran, téléchargement), même sur compte privé.
2. Ne pas divulguer d’informations personnelles : ne mentionnez jamais le nom complet, l’école, l’adresse, la routine ou les activités régulières de l’enfant. Les métadonnées (géolocalisation, hashtags, date, lieu) peuvent permettre à des personnes malveillantes de reconstituer un profil.
3. Masquer l’identité de l’enfant : floutez le visage de l’enfant, utilisez un emoji, ou privilégiez des photos prises de dos ou en profil. Cette précaution ne garantit pas l’anonymat complet, mais réduit considérablement les risques.
4. Associer l’enfant à la décision : lorsque l’enfant est en âge de comprendre, demandez son consentement avant toute publication de son image. Respectez son opinion selon sa maturité et donnez-lui une voix à mesure qu’il grandit.
5. Adopter une posture de sensibilisation bienveillante : l’objectif n’est pas de culpabiliser les parents, mais de les inviter à réfléchir à leurs pratiques, à dialoguer en famille, d’échanger, de parler avec leurs enfants d’internet et des réseaux sociaux et à se forger une éducation numérique responsable.
De manière générale, on invite les parents à se poser la question de : pourquoi vous postez cette photo ? Car à la seconde où vous le faites, elle ne vous appartient plus. Est-ce que ce n’est pas quelque chose que vous pouvez garder pour vous ?