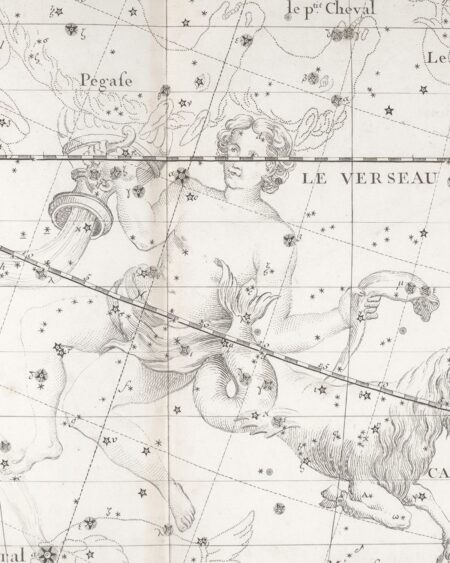Et si le mot « viol » avait été le grand absent du procès Mazan ? C’est l’analyse de Mathilde Levesque qui publie aux éditions Payot l’essai « Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » . Cette professeure agrégée de lettres modernes, docteure en langue et littérature françaises et spécialiste de l’éloquence, s’est rendu aux audiences du procès pour en décortiquer la sémantique, symptomatique d’une société baignée dans la culture du viol et incapable de le reconnaître… Contournement des faits, minimisation de leur gravité, inversion de la culpabilité, création de vérités alternatives – souvenez-vous du « il y a viol et viol »- les propos tenus au procès des viols de Mazan ont pu ressembler à un (honteux) exercice d’esquive. « Il y a viol, mais je ne suis pas un violeur ». Mathilde Levesque nous éclaire sur un procès qui en dit long sur le système de domination et d’agression à l’œuvre dans la société française… voire occidentale.
Crédit illustration de couverture – Joseph K. Roman
Mathilde Levesque, vous publiez un essai aux éditions Payot intitulé « Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » dans lequel vous avez choisi de vous intéresser à la sémantique du procès. Qu’est-ce qui vous a poussée à assister aux audiences puis à écrire sur la sémantique déployée ?
J’ai eu l’occasion de me rendre pas très loin d’Avignon à la mi-octobre et j’ai souhaité aller aux audiences pour vérifier – ou non – l’intuition que j’avais : dans ce procès les mots étaient souvent détournés de leur sens, et le langage de ses fonctions. Les différentes parties me semblaient parfois sortir du rôle qui leur est traditionnellement assigné.
Le problème de ce procès, et je ne suis pas la seule à le dire, c’est qu’il est impossible de n’y venir qu’une fois. Y aller, c’est avoir besoin d’y revenir. Pour essayer de comprendre.
Mathilde Levesque
Tout l’enjeu de votre réflexion est de montrer qu’il y a eu un grand absent dans ce procès : c’est le mot « viol » qui ne s’est imposé dans aucune bouche, que ce soit celles des 51 accusés (sauf exception), de leurs avocats, mais aussi des juges, des experts… Quels exemples vous ont le plus frappée durant le procès et en quoi est-ce révélateur d’un déni collectif ?
Le mot viol était bien sûr présent dans la bouche de la partie civile et du ministère public. Il peut difficilement être employé par la Cour, dans la mesure où tout l’enjeu du procès est de déterminer s’il y a bien eu viol, autrement dit, comme l’exige le Code pénal, matérialité et intentionnalité de l’acte.
Du côté des accusés, le contournement de viol peut s’entendre car la prononciation du mot est liée à l’acte d’aveu, et donc à une potentielle lourde peine. Les accusés comme leurs avocats ont pu prononcer le mot, mais c’était souvent alors pour le mettre à distance : viol à contrecoeur, viol par contrainte, viol involontaire… Sinon, les stratégies consistaient plutôt à atténuer la crudité du mot et, derrière, de sa réalité. La plasticité du mot viol dans ce procès a d’ailleurs été posée très tôt par la désormais célèbre formule de maître de Palma : « Il y a viol et il y a viol ».
Vous démarrez votre essai par une réflexion intéressante sur le choix de Gisèle Pelicot d’être représentée par deux hommes et de Dominique Pelicot par une femme. Comment analysez-vous ce choix de part et d’autre ?
Je ne l’analyse pas moi-même et ne me le permettrais pas. J’ai interrogé les avocats de l’ancien couple Pelicot sur cette question et ce sont leurs réponses que je peux vous donner. Dominique Pelicot met en avant le fait qu’à ses yeux une femme allait mieux le comprendre : on peut y voir une forme de cliché de la sensibilité féminine, supposément plus apte à l’empathie. Pour Gisèle Pelicot les enjeux sont différents : le fait d’être représentée par des hommes est pour elle l’occasion de montrer que ce procès ne doit pas être celui qui oppose les hommes et les femmes. Il s’agit au contraire de réfléchir, a-t-elle dit plusieurs fois, à la façon dont toutes et tous pourraient mieux vivre ensemble.
On a retenu la formule « Il y a viol et viol » tenu par l’avocat d’un des accusés, Maître de Palma et qui a fait bondir les collectifs féministes : est-ce cela la particularité de la stratégie de défense des 51 accusés ? Changer la réalité des mots et les vider de leur sens ?
En réalité je pense que cette formule a surtout heurté en raison du positionnement de maître De Palma, qui à cette occasion a prétendu qu’il s’adressait à la cour et non à la presse, donc qu’il employait le sens juridique de viol et non son sens d’usage. Il est certain que la définition du viol n’est pas identique dans le dictionnaire et dans le Code pénal, mais ce n’est pas un scoop dès lors que c’est le cas pour la plupart des mots (intention, par exemple). En créant une fausse polysémie, il a donné l’impression de nier le réel.
Pour ce qui est des accusés, il y a autant d’explications que d’hommes. Je pense que la réalité du viol est psychiquement insoutenable y compris quand il s’agit d’admettre qu’on l’a commis, sauf dans le cas (non majoritaire dans ce procès) des pervers. On a pu en effet assister à de nombreuses stratégies d’esquive pour ne pas se confronter au réel, quitte à créer des réalités alternatives. Mais je ne pense pas que cela soit propre aux accusés ni même à leurs avocats, qui ne sont à mes yeux que des symptômes de nos propres fonctionnements sociaux face à l’horreur autant que l’omniprésence des violences sexuelles.

Mathilde Levesque – crédit photo Olivier Dion
Vous avez été touchée durant le procès par les témoins appelées à la barre : quasi exclusivement des femmes, compagnes et ex-compagnes des accusés, devant répondre des agissements de leur (ex)conjoint. En quoi leur position dans le procès vous a paru là encore révélatrice d’une inversion de culpabilité les poussant à dire ce que eux ne veulent pas nommer ?
Les témoins étaient en effet majoritairement des femmes. Elles m’ont semblé être particulièrement malmenées, d’abord par la contrainte de l’extime, c’est-à-dire qu’il leur était demandé d’exposer leur propre vie sexuelle avec les accusés, dans la perspective de faire une « évaluation » de la déviance des hommes. C’était visiblement une épreuve douloureuse pour elles, et elles l’ont verbalisé.
Mais il y a autre chose. C’est également à elles que l’on demandait ce qu’elles connaissaient des « faits » : autrement dit, là où les hommes refusaient de dire, c’est à elles qu’on demandait de verbaliser le crime.
Se déresponsabiliser a été l’une des stratégies les plus répandues de la part des accusés, 25% d’entre eux évoquant notamment des agressions sexuelles dans l’enfance et donc une vision erronée de la « norme » en ce qui concerne les relations sexuelles. « J’ai été agressé, donc ce n’est pas de ma faute si je deviens agresseur » : pourtant, cet argument ne fonctionne pas au féminin si l’on s’en tient aux statistiques (très peu d’agresseuses). Comment se fait-il que cet argument de défense trouve encore sa place dans un procès pour violences sexuelles ?
Il faut revenir ici aux analyses de Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations au sujet de l’inceste.
Bien sûr que le fait d’avoir été violenté sexuellement dans l’enfance ne suffit pas à expliquer la reproduction des violences sexuelles, comme le montre l’écart vertigineux entre le nombre de victimes féminines et la faible proportion de passages à l’acte dans cette même population.Certains avocats de la défense utilisent le passé traumatique comme quelque chose qui relèverait de la circonstance atténuante, et je ne suis pas habilitée à dire si cela est pertinent ou non.
Ce que je me demande en revanche – sans avoir la réponse – c’est ce que seraient devenus ces enfants violés s’il y avait eu la moindre place pour leur parole dans la société lorsqu’ils étaient enfants. On doit aussi s’interroger en tant que société sur la place qu’on laisse aux enfants victimes de violences sexuelles.
Je vous cite :
« Une chose est sûre, ce procès rend visible la haine des femmes – au mieux ignorées, au pire objectifiées. »
Mathilde Levesque
On a pu voir le lexique de la pensée masculiniste s’inviter dans les arguments de la défense où il a été question de parler de « misère sexuelle », de « besoins » inhérents à l’homme, de « pulsions », de « consentement par procuration ». Pour vous, il s’agit plutôt des symptômes d’une société capitaliste. Qu’entendez-vous par là ?
Je dirais plutôt qu’il s’agit aussi des symptômes d’une société capitaliste, autrement dit d’une société qui fait de la femme une marchandise à disposition au même titre que d’autres. Par ailleurs la conviction qu’il existe des pulsions et des besoins des hommes (lesquels les font se sentir autorisés à se servir des corps) ne me semble pas être l’apanage du discours masculiniste ; je l’ai entendue ailleurs, dans et en dehors du procès.
Vous déplorez l’usage à outrance de ces termes : « courageuse », « digne » et « icône » à destination de Gisèle Pelicot, pourquoi ?
Je le déplore d’une part parce que ces mots vont à l’encontre d’un principe fondamental dans l’approche des violences sexuelles : ne pas parler à la place de la victime. Gisèle Pelicot a régulièrement dit qu’elle était détruite, telle un champ de ruines. En faire une icône, une survivante, une warrior, c’est faire fi de son statut de victime. D’autre part, évoquer sa dignité c’est partir du principe qu’il pourrait donc exister des victimes indignes – probablement les mêmes que celles dont on met toujours la parole en doute. Or, la levée de huis clos demandée par Gisèle Pelicot avait un seul objectif selon elle : permettre la libération de toutes les paroles de victimes. Ces dernières pourraient, face à l’iconisation d’une victime par ailleurs en possession de preuves, se décourager de porter plainte. Je ne crois pas que ce soit l’intention de Gisèle Pelicot.
Vous développez dans votre essai l’idée d’un procès de la masculinité. De quelle(s) masculinité(s) parlez-vous ?
J’interroge surtout la masculinité à laquelle s’attaque ce procès. Je me permets de rappeler que le mot masculinité désigne tout bonnement l’ensemble des caractéristiques associées au masculin. On pourrait tout à fait prendre une responsabilité sociétale et décider de changer l’extension du mot, c’est-à-dire l’ensemble des choses auxquelles il s’applique. Par exemple, le « besoin irrépressible de sexe » pourrait – devrait – ne plus entrer dans l’extension du mot.
Je veux croire qu’il est possible de penser une masculinité qui, dans chacun de ses critères définitionnels, ne porte pas la possibilité du viol.
Mathilde Levesque
En quoi pour vous le procès Mazan a été un observatoire privilégié du système de domination et d’agression à l’œuvre dans la société française et sans doute dans les sociétés occidentales ?
C’est difficile de répondre brièvement car l’ensemble du livre vise à démontrer cela. Je dirais que l’étude des discours de ce procès montre à quel point la violence s’auto-légitime en refusant de se confronter au réel. La responsabilité passe par le fait d’assumer ses actes : or, le recours fréquent aux tournures passives dans la bouche des accusés montre une nette tendance à devenir un être passivé, manipulé, dès lors qu’il s’agit d’assumer l’état actif de l’agression. Sur ce point, ils sont loin d’être les seuls.
Enfin, ne serait-ce que pour la promotion de ce livre, il est difficile, si ce n’est impossible d’écrire le mot « v*ol » sur les réseaux sociaux sans être potentiellement censurée. Quels dangers ces derniers représentent-ils pour les combats féministes qui passent notamment par « nommer » les agressions ?
C’est toute la raison d’être de ce livre : en faisant disparaître les mots on fait disparaître la réalité qu’ils désignent – en l’occurrence le crime.
L’impossibilité de nommer les choses a des conséquences dramatiques pour les combats féministes.
Mais je ne sais pas s’il faut isoler ces derniers de l’ensemble des combats sociétaux. L’action récente de l’administration Trump visant à supprimer certains mots des articles de recherche laisse craindre le pire. En supprimant des mots comme d’autres l’ont fait avant lui (voir à ce sujet les travaux de Rithy Panh ou de Klemperer), Trump pense créer un monde où disparaissent les choses qui l’encombrent. Ce n’est pas aussi simple que ça, mais il faut rester vigilant.e.s, et se souvenir des leçons d’Orwell : on finit bien par faire disparaître les choses à force de ne plus avoir le moyen de les nommer.
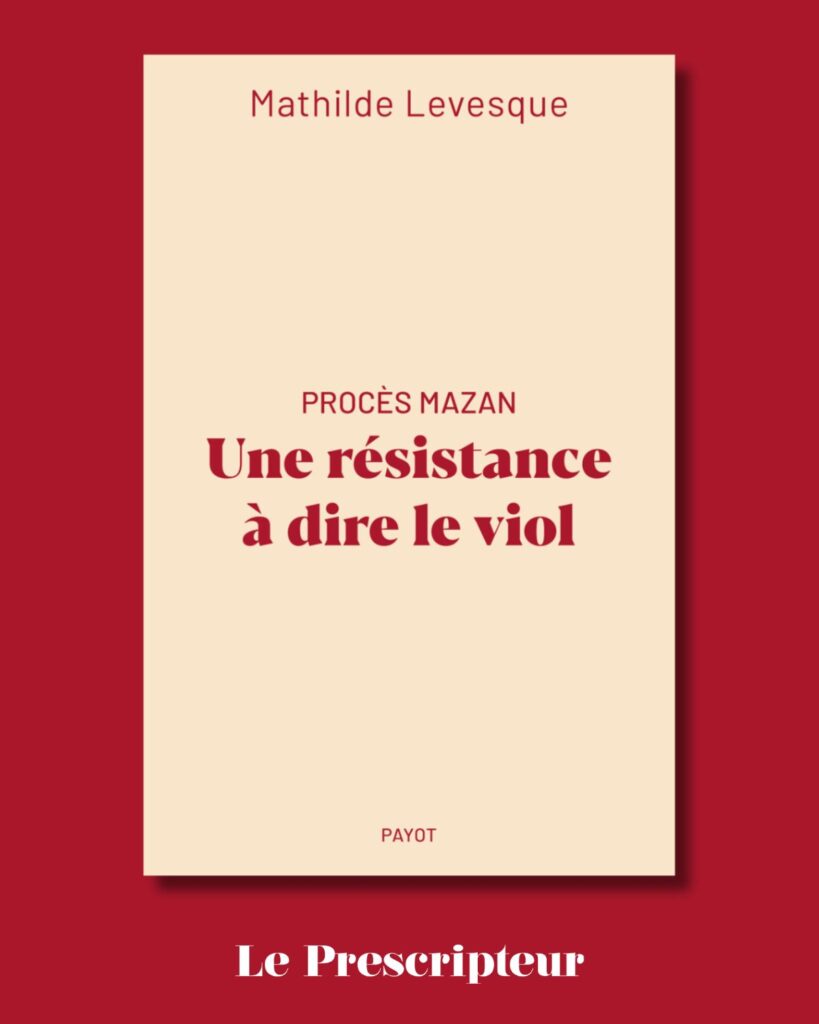
« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol », de Mathilde Levesque (éditions Payot – 8€)
Les passages que j’ai surlignés dans son livre :
Il ne faut pas oublier que le silence de toutes celles qui ne parlent pas naît du silence de ceux qui jamais n’ont avoué.
Mathilde Levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.51)
Dans le procès Mazan, ce n’est pas le monstre qui sédate, ce n’est pas le monstre qui viole, puis qui nie le viol : c’est l’homme, et il faut l’entendre si l’on veut avancer.
Mathilde Levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.120)
Lors de sa dernière audition, Dominique Pelicot a fini par livrer son « mobile » : il voulait « soumettre une femme insoumise ».
mathilde levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.113)
Il faut rester vigilant quand un pouvoir interdit des mots pour éviter qu’on puisse contester la réalité qu’ils désignent.
Mathilde Levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.18)
A l’échelle sociétale, notre responsabilité est double : savoir nommer le viol d’une part, et d’autre part se livrer toutes et tous à une introspection individuelle pour interroger notre place dans le continuum des violences sexistes et sexuelles.
Mathilde Levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.134)
La dernière structure qui a pu autoriser les viols de Mazan est le discours de la société capitaliste dans lequel la femme est à disposition, source de profit, comme n’importe quelle autre marchandise.
Mathilde Levesque
(« Procès Mazan – Une résistance à dire le viol » p.142)