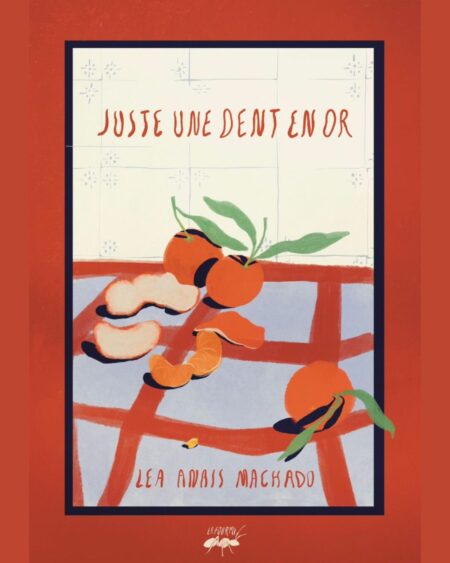Nominée cette année aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation, Roni Alter dévoile dans son troisième album des chansons à la sensibilité rare. Une mise à nue totale de l’artiste d’origine israélienne et basée à Paris, qui revient sur le harcèlement sexuel qu’elle a vécu à l’âge de 8 ans, sur sa relation compliquée avec sa mère, sur son non-désir d’enfants. Des sujets graves abordés au rythme mélodies pop nourries au jazz…
Tu viens d’une famille d’artistes. Ta mère était actrice, ton père réalisateur… Décris-nous les couleurs de ton enfance.
Ma maison était pleine de différentes cultures artistiques. Mon père est aussi compositeur, il écrit des chanson au piano. Dans mon enfance, ma maison était toujours pleine de personnes venant du milieu artistique : des actrices, des musiciens… Il y avait beaucoup de joie et mes parents organisaient très souvent des soirées. Pour moi, cette enfance n’était pas exceptionnelle, j’ai baigné dans cette univers en pensant que tout le monde vivait de cette manière ! (rires) Ma mère m’inscrivait à des tonnes d’activités : j’ai fait de la danse classique, du judo, du tennis, de la piscine, de la peinture… Elle m’a fait découvrir plein de choses pour que je choisisse ma voie, c’était très important pour elle. J’ai commencé le piano et le saxo quand j’avais 8 ans.
Quel genre de chansons composait ton papa ?
Il composait des chansons pour moi et mon frère pour nous aider à nous endormir quand nous étions petits. Il a aussi composé deux chansons pour mon premier album !
En 2012, tu décides de quitter Tel Aviv pour t’installer à Paris. Pourquoi ?
Avant mon premier album, je faisais partie d’un groupe électro-pop, presque l’opposé de ce que je fais aujourd’hui ! (rires) On a énormément tourné. Après la sortie de mon premier album solo en 2010, j’ai commencé une tournée. J’ai eu besoin de sortir de ma zone de confort, trouver quelque chose qui me challenge et Paris était pour moi la meilleure ville pour cela. Je connaissais déjà bien la ville car ma sœur y avait emménagé à ses 20 ans. En plus mon mec est photographe de mode. Cela avait du sens. On pensait venir pour 6 mois et finalement, cela fait 6 ans que nous sommes ici.

Tu n’aimes pas qu’on mette des étiquettes sur ta musique…
C’est vrai ! Car je ne pense pas spécialement à un style de musique quand je compose, je ne me mets aucune barrière. Alors ok, je ne fais pas du rap ni du hip-hop ! (rires) Mais je dirais que ma musique est un mixe de beaucoup d’influences. Dans mon dernier album, je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit.
Ton EP Roni Alter a été sélectionné aux Victoires de la musique cette année dans la catégorie Révélation. Comment as-tu vécu cette nomination ?
C’était énorme. Je n’arrivais plus à respirer pendant la remise des prix. L’énergie était incroyable. J’ai rencontré Angèle, Clara Luciani, Thérapie Taxi… J’ai adoré l’album de Foé et on aimerait beaucoup faire quelque chose ensemble. C’est un rêve, je ne sais pas s’il se réalisera !
Ton 3ème album est très personnel. Dans la chanson Devil’s Calling, tu parles d’harcèlement sexuel vécu dans ton enfance. Cette chanson fait-elle partie de ta résilience ?
Je pense. Je ne pensais pas écrire un jour sur ce qui m’était arrivé. J’étais un jour chez ma psy et je n’arrêtais pas de parler avec elle de cette histoire. J’ai réalisé que j’avais beaucoup de doutes autour de cette histoire, de zones d’ombre… J’y pensais énormément. Un soir, je me suis réveillée d’une sieste, j’ai attrapé ma guitare et les mélodies et les mots sont sortis d’un coup. C’est une guérison pour moi de laisser cette petite fille de 8 ans, de grandir et de dépasser ce qui m’est arrivé, car cela aurait pu être bien pire ! Je pense que mon envie d’en parler n’est pas étranger à la vague #metoo, j’avais envie de partager mon expérience. J’ai reçu quelques messages de personnes qui avaient vécu des situations similaires et ils me disaient que ma musique les aidait à se sentir moins seuls.
Dans Save Me, tu parles de ta relation conflictuelle avec ta mère. A-t-elle été énervée de découvrir cette chanson dans ton album ?
On ne se parle pas beaucoup avec ma mère, mais c’est ma première fan. Elle me soutient énormément. Elle sait que notre relation est très compliquée, elle n’est pas aveugle ! J’ai joué cette chanson à mon grand frère et ma grande sœur avant de l’enregistrer et ils m’avaient dit « Ok, cette chanson est magnifique, mais tu ne peux pas sérieusement la sortir ! Ca tuerait maman ! ». Mais je n’étais pas de cet avis. Je ne dis pas dans cette chanson que je n’aime pas ma mère. Elle l’a entendue alors qu’elle était en voiture avec ma sœur, elle chantait les refrains ! (rires)
Dans The Plague, tu parles des femmes qui ne souhaitent pas d’enfant. Tu en fais partie ?
Je parle de moi, oui. La majorité de mes amies ont des enfants. C’est une plaie. Parfois cela me fait penser que je suis la seule personne saine d’esprit ! Notre société ne comprend pas les femmes qui ne désirent pas d’enfants. Particulièrement en Israël, à partir de tes 27 ans on te demande pourquoi tu n’as pas d’enfant. Et quand tu en as un, on te pose la question du deuxième. C’est un poids pour moi…
De quelle chanson aimerais-tu nous parler ?
De Nail me to the ground. C’est l’essence de ce que je suis aujourd’hui. Je vis à Paris mais je suis une étrangère. Je n’ai pas envie de te dire immigrée car cela sonne très politique, mais c’est ce que je suis ! J’ai une jambe à Paris et une autre jambe en Israël. Cette chanson parle de ma vie à Paris, de mes rêves, mais aussi du fait que mes racines sont ailleurs, que ma famille est ailleurs, que mes amis sont ailleurs. Je ne veux pas que ma « Israëlité » disparaisse.
Quelle adresses à Paris recommandes-tu pour retrouver les saveurs d’Israël ici ?
Le Balagan, rue d’Alger. Ils servent une cuisine méditerranéenne avec des plats végétariens. Balagan veut dire bordel. C’est une super expérience d’aller là-bas, c’est mon spot. J’y vais au minimum 2 fois par semaine !