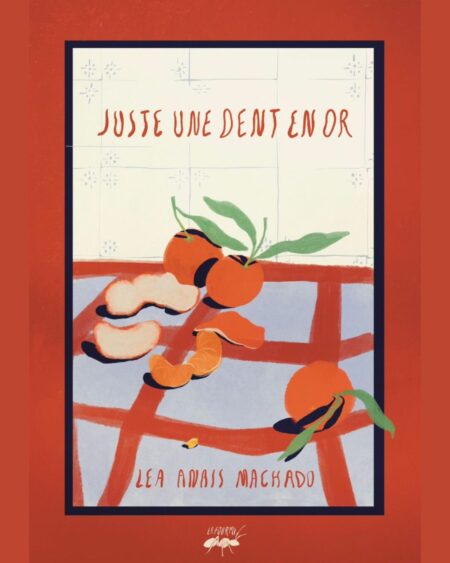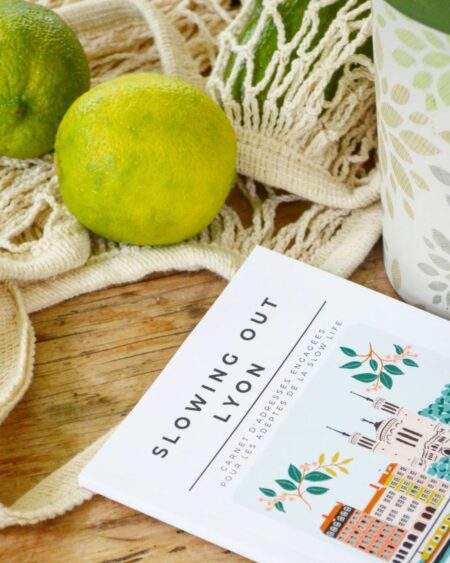La thanatopraxie vient du grec ancien thanatos qui signifie « mort » et de praxie qui signifie « action ». Les thanatopracteurs désignent ainsi les personnes qui prodiguent des soins de conservation aux défunts pour nous permettre de leur rendre un dernier hommage. C’est le métier de Stéphanie Sounac, plus connue sur instagram et Tik Tok derrière le pseudo @thana_nanou. Sur ses comptes, elle partage son quotidien de thanatopractrice et nous invite à accueillir la mort au centre de nos vies.
Et vous allez me dire… quel genre de personne choisit une si curieuse profession ?
Je me suis posée la même question ! Aussi me suis-je empressée de lire son livre fraîchement sorti aux éditions 41, « Les yeux qu’on ferme, récit d’une thanatopractrice » et… J’ai découvert une profession de l’ombre qui mérite pourtant toute la lumière. J’ai compris l’importance de leurs gestes pour permettre aux familles de faire le deuil de leurs proches. J’ai réalisé la complexité de leur intervention et toute leur dimension artistique : comment rendre visible un défunt qui a pris une balle dans la tête ? Comment honorer une mamie coquette ? J’ai ouvert les yeux sur le monde funéraire : là où la mort fait partie de la vie.
Rencontre sans filtre avec celle qui milite pour une meilleure écoute des enfants endeuillés, et pour la reconnaissance d’une profession qui nous concerne toutes et tous !
Votre vocation de thanatopractrice, vous la devez à un deuil que vous avez eu beaucoup de mal à faire : celui de votre père décédé d’un accident de moto alors que vous avez 7 ans…
J’ai choisi ce métier en me disant que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que personne – ni adulte, ni enfant – ne soit privé de voir son proche décédé si tel est son désir et si ce désir est techniquement réalisable.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Cette mission, je la dois aux adultes qui m’ont empêchée de voir mon père défunt et de lui dire adieu car cette décision, prise sans mon accord, sans même me consulter, a été le facteur aggravant de mon traumatisme. Les répercussions ont été multiples, à la fois sur ma construction psychique, sur ma santé et sur mes relations aux autres. Le drame qui s’est joué pour moi, à la suite de cette absence de confrontation avec le corps de mon père, c’est d’avoir assimilé sa mort à un abandon. Car j’avais besoin de voir pour croire.
La pédagogie que vous déployez sur vos réseaux sociaux et dans votre livre pour expliquer votre métier de thanatopractrice vise aussi et surtout à défendre les enfants endeuillés. Pensez-vous qu’on ne les écoute pas assez ?
Je pense qu’on ne réalise pas suffisamment qu’un enfant est en capacité de comprendre et de choisir s’il souhaite voir ou non un défunt quand on lui explique les choses simplement.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Et quand je dis expliquer les choses simplement, cela veut dire être clair dans ses mots en évitant les figures de style du type « Il s’est endormi pour toujours », qui peuvent par exemple poser des problèmes d’endormissement chez l’enfant par la suite ! Quand un adulte utilise ce genre d’images pour expliquer la mort à un enfant, ce sont eux-mêmes qu’ils protègent, pas leur enfant.
Beaucoup de parents ne savent pas comment réagir au décès d’un proche, ce qui est parfaitement compréhensible : comment en parler à leur(s) enfant(s) ? Il ne faut pas hésiter à appeler un pédo-psychologue et poser des questions en cas d’incertitude car bien évidemment on n’est pas toujours préparés à la mort de quelqu’un.
Vous déployez dans votre livre une certaine idée du deuil qui ne nous quitte jamais vraiment…
Malgré tout ce chemin aux côtés de la mort, je sais que le deuil de mon père ne me quittera jamais. Et je l’accepte. Contrairement aux psychologues qui disent que le deuil est forcément pathologique au bout d’un certain temps, pour moi, le deuil est en quelque sorte le reste de ma vie après le drame de la mort de mon père, une nouvelle étape après laquelle je suis devenue totalement différente.
Une expérience vous a réconciliée avec la mort et confortée dans l’idée de travailler dans le milieu funéraire : c’est celle du décès, à l’hôpital, du père d’un ex petit ami auquel vous avez assisté. En quoi cela vous a ouvert les yeux ?
Assister à son décès a été pour moi un cadeau de la vie. Cela m’a permis de comprendre que la mort n’est pas que douleur, choc, chaos, traumatisme ou disparition. J’ai compris qu’elle pouvait aussi être libératrice et apaisante. Qu’on pouvait même parfois avoir envie de dire « merci ».
Être thanatopratrice, c’est « être une professionnelle pratiquant des soins de conservation ou de présentation sur le corps des défunts », selon la définition du Larousse. Mais en quoi consiste un soin de conservation ?
Le soin de conservation est un procédé invasif qui vise à ralentir le phénomène naturel de décomposition.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Il se déroule en plusieurs étapes précises que je décris dans les grandes lignes dans mon livre.
Après identification du défunt, on lave et désinfecte le corps. On introduit un mélange de formaldéhyde et d’eau par le système artériel, souvent par les artères carotides, brachiales et fémorales. Ce liquide va permettre l’hydratation des tissus et leur recolorations. On estompe ainsi les taches violettes – appelées lividités – qui apparaissent peu après le décès et on se rapproche d’une coloration naturelle. Les signes de saturation des tissus, comme la rigidification des globes oculaires, indiquent qu’on peut passer à l’étape suivante.
On pratique alors une ponction thoracique et abdomino-pelvienne pour récolter un maximum de liquides biologiques tels que l’urine, l’ascite, le sang, qui se logent dans les cavités par effet d’apesanteur. On n’enlève donc pas les organes, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. A la fin du drainage, on effectue un méchage des orifices.
Durant tout ce temps, on prend soin du corps du défunt. Il faut le désinfecter, le laver et le masser pour aider au passage des fluides. Les mouvements de flexion et d’extension impulsés au corps servent également à rompre la rigidité cadavérique qui débute entre deux heures et quatre heures après le décès pour atteindre son intensité maximale entre huit et douze heures. Elle se maintiendra de douze à trente-six heures avant que le processus de ramollissement, puis de putréfaction ne débute.
C’est surtout au niveau des membres supérieurs qu’on intervient. On conserve, autant que possible, la rigidité des membres inférieurs, ce qui facilite l’habillage du corps. La plupart du temps les vêtements et accessoires éventuels sont fournis par la famille ou ont été préparés en amont par le défunt lui-même.
Le soin se termine par l’aspect esthétique (maquillage, coiffure…).
Par le soin, je ne camoufle pas ce que la mort fait aux gens. Ceux qui restent doivent pouvoir se rendre compte qu’elle est à l’œuvre afin de sortir de leur incrédulité et commencer leur deuil. Mais j’atténue les chocs visuels qui seraient traumatisants pour la famille, en veillant à ne pas dénaturer les personnes pour autant.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
L’aspect esthétique amène souvent une dimension artistique à votre métier de thanatopractrice. Dans quelles circonstances l’avez-vous le plus ressenti ?
A l’occasion de toutes les reconstructions auxquelles j’ai eu affaire !
Je raconte d’ailleurs dans mon livre la première fois que j’ai eu à réaliser une reconstruction : il s’agissait d’un défunt qui avait reçu une balle en plein visage. La balle avait littéralement explosé une grande partie de la pommette, emportant l’œil dont la cavité n’était plus qu’un trou. L’homme était défiguré.
Je raconte aussi comment, onze ans plus tard, je suis contactée par une conseillère funéraire pour m’occuper d’un défunt qui a eu un cancer ORL et n’a plus de nez. Je me suis rendue dans un magasin créatif pour y chercher de la pâte à papier mâché. C’est un matériau très solide une fois sec et aussi très léger. Durant trois heures, j’ai mis toutes mes compétences en œuvre pour restaurer ce visage, ne cessant de regarder la photo de cet homme avant que la maladie ne le défigure.
Donc oui, mon métier, parfois, c’est aussi de l’Art. D’ailleurs on appelle ce genre d’intervention de l’Art restauratif, comme pour les tableaux ou les sculptures qui ont souffert des outrages du temps. On peut considérer que j’exagère, mais les compétences que nous mettons au service de chefs-d’oeuvres, seraient-elles moins nobles parce qu’elles s’exercent sur les chairs et qu’elles sont vouées à l’éphémère ?
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Récemment, on m’a appelée en urgence pour m’occuper d’une défunte qui était tombée trois fois sur la face peu avant de décéder. Elle avait les couleurs de l’arc en ciel sur son visage. J’ai rassuré les pompes funèbres : je savais que cette intervention allait être simple, le maquillage fait des merveilles.
J’honore la pudeur et la mémoire de ceux auxquels s’adressent ces derniers soins. Je rends possible certains adieux qui, sans cela, ne pourraient avoir lieu.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Dans votre livre, vous n’épargnez pas les lecteurs des détails de votre quotidien : au contraire, vous nous plongez dans la réalité de votre métier, celle au contact de la mort, l’odeur des corps des défunts, leur état de décomposition possible, leur rigidité, les produits chimiques que vous manipulez, vos outils… Ce réalisme est essentiel à vos yeux ?
C’était important pour moi qu’il n’y ait pas de tabou dans mon livre car c’est mon combat de tous les jours, c’est ce que je fais depuis 17 ans ! Tout ce que j’explique dans ses pages répond aux questions que je reçois au quotidien sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas avoir à me soucier d’épargner les lecteurs, et c’était d’ailleurs une volonté partagée par ma co-autrice Frédérique Martin. Le métier de thanatopractrice est encore trop peu connu et j’avais conscience que beaucoup de personnes intéressées par ce métier allaient lire mon livre : je ne voulais pas qu’ils s’imaginent que c’est tout beau tout rose tous les jours.
Ce réalisme et cette honnêteté dans l’écriture, je l’ai aussi dans l’exercice de ma profession.
Je n’ai aucun intérêt à ne pas expliquer à la famille d’un défunt pourquoi je ne peux pas intervenir sur le corps de leur proche, car le restant de leur vie ils vont chercher à savoir pourquoi, pourquoi n’est-elle pas intervenue. Ce n’est pas les protéger que de leur épargner les raisons concrètes de l’impossibilité d’un soin de conservation de ma part : par exemple, si le corps a été brûlé, s’il a séjourné longuement dans l’eau, si les dégâts d’une autopsie sont irrattrapables, si le corps est entré dans un état de décomposition trop avancé…
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Vous expliquez que le métier de thanatopractrice est un métier d’improvisation : aucune journée de travail n’est prévisible ?
Chaque jour, mon travail va dépendre des défunts de la journée.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
C’est ce que j’apprécie dans ce métier : on ne sait jamais à l’avance ce qui nous attend, il faut innover et continuer à apprendre ! Je suis en recherche permanente de nouvelles matières qui me permettront de faire encore mieux et d’aller plus loin dans mon travail.
Récemment, une pompe funèbre avec laquelle je n’avais encore jamais travaillé m’a appelée et demandé d’intervenir sur une défunte qui avait une nécrose du nez qui lui déformait le visage. J’ai accepté tout de suite. Je ne savais pas à quoi m’attendre car on ne m’envoie jamais de photos : quelle partie du nez est endommagée ? Est-ce la narine ? Si c’est le cas, cela risque d’être très délicat de faire tenir une fausse narine car tout l’enjeu est de permettre à la famille qui viendra peut-être embrasser une dernière fois la défunte, de ne pas repartir avec une partie de ma reconstruction ! Dans tous les cas, j’essaie toujours de faire au mieux pour la famille.
Dans votre livre, vous dénoncez le parcours du combattant pour devenir thanatopractrice, le manque cruel d’informations autour de la profession et la difficulté pour se former. Comment l’expliquez-vous ?
C’est un parcours du combattant pour celles et ceux qui souhaitent exercer ce métier car il y une obligation de faire un stage d’observation avant d’intégrer l’école consacrée. Or, peu de thanatopracteurs acceptent de prendre des stagiaires car beaucoup n’obtiennent pas le diplôme et n’exerceront pas la profession. Ce qui peut être particulièrement décourageant. Il y a aujourd’hui un numérus clausus de 65 places pour 350 à 400 inscrits chaque année. Par ailleurs, beaucoup de jeunes diplômés vont exercer pendant deux ou trois ans et s’arrêter pour des raisons de frustration financière, de trop grosse pression ou encore pour des raisons physiques (tendinites, problèmes de dos) et psychologiques, cela reste un métier difficile moralement. Finalement, il y un manque de reconnaissance de ce métier qui est presque un métier fantôme dont on parle très peu.
Ce livre est conçu comme un hommage aux défunts. Quel lien entretenez-vous avec eux ?
En tant que thanatopracteur, nous sommes les dernières personne à prendre soin de ces corps qui ont eu une vie, qui sont encore aimés. J’ai écrit ce livre effectivement pour leur rendre hommage.
Je me sens mieux entourée de défunts que de vivants. Le défunt ne peut pas me blesser, me faire du mal, me décevoir…
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Moi qui suis hypersensible, je trouve le monde des vivants bien plus violent que celui des défunts, bien que je sois amenée dans mon travail à voir l’innommable.
Comment avez-vous accueilli ce projet de livre qui vous a été proposé par les éditions 41 ?
Certains amis m’avaient déjà dit que je devais écrire un livre ! Cette idée a fait son petit bonhomme de chemin. J’avais déjà commencé à écrire quelques petites choses pour me souvenir d’émotions ressenties, de défunts… Et puis en 2023, un article sur mon travail a attiré l’attention d’une maison d’édition qui m’a proposé d’écrire un livre. Au début j’ai cru à une blague et ait demandé à une amie qui travaille dans le milieu de l’édition si le message que j’avais reçu était sérieux ! Je me suis dit que c’était un immense privilège d’avoir cette opportunité de vie ! Ce n’est pas banal de pouvoir écrire un livre et toucher autant de personnes avec nos messages. Et puis c’est aussi laisser un souvenir de vie à mes enfants. Je me suis rendue compte avec ma co-autrice, que j’étais très pudique sur les choses que j’avais pu traverser dans ma vie. Le livre vient lever quelques voiles.
Justement, racontez-vous votre quotidien de thanatopractrice à vos enfants, comme tout parent rentrant du travail et partageant une anecdote ?
Oui, je leur raconte ! Je suis entourée de personnes qui travaillent dans le funéraire. Lors des repas entre amis, on se raconte nos boulots et les enfants ont l’habitude de nous entendre en parler, bien que l’on fasse attention à ne pas raconter des choses traumatisantes pour eux.
Mon dernier de 4 ans m’a surprise récemment en me disant : « Toi, tu fais beaux les morts » : c’est très clair dans leur tête ! Ils saisissent de quoi on parle, et ça ne leur fait pas peur. La mort fait partie de leur vie.
Stéphanie sounac, thanatopractrice
Votre livre vise-t-il finalement à remettre la mort au centre de nos vies ?
Tout à fait. Au-delà des enfants endeuillés qui restent le combat de ma vie, mon message est aussi et surtout qu’on ne doit pas mourir avec nos morts.
Les défunts m’ont appris la vie.
Stéphanie sounac
Sans ce travail de thanatopractrice, je n’aurais jamais eu d’enfants, je ne me serais peut-être pas mariée. J’aurais vécu constamment dans la peur de perdre. Or on ne doit pas mourir avec nos morts.
Je vous invite à lire le livre de Stéphanie Sounac, « Les yeux qu’on ferme – Récit d’une thanatopractrice », paru aux éditions 41 (22€)