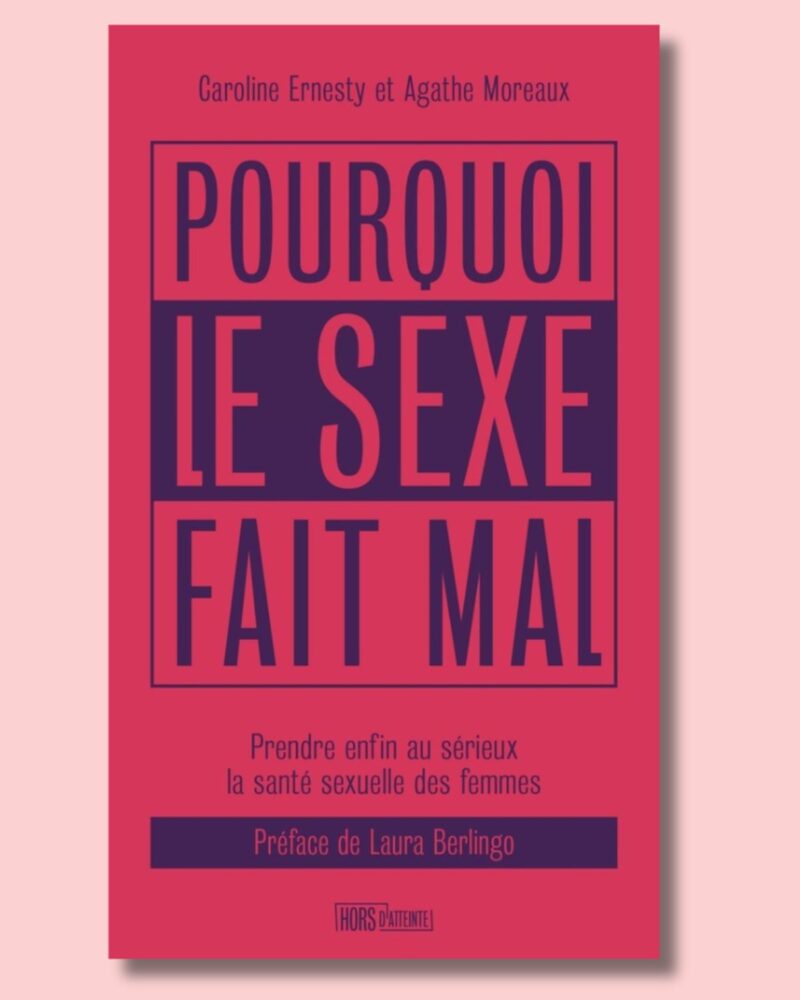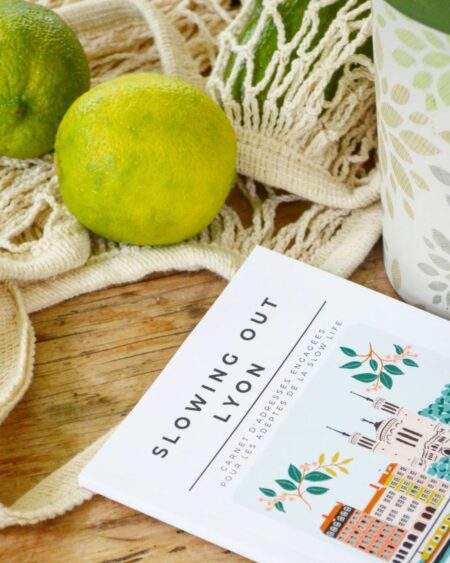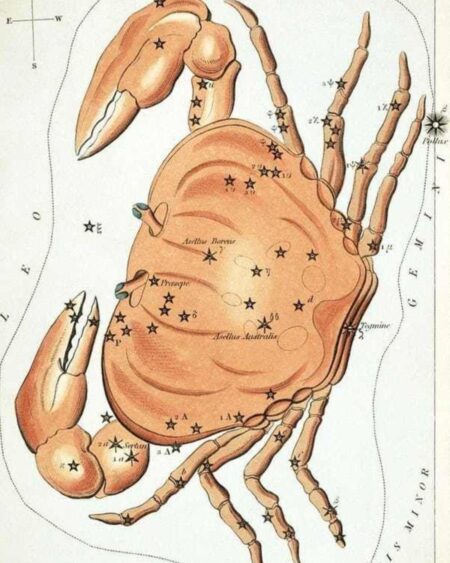« Imaginez si les hommes étaient pris de douleurs après chaque rapport sexuel, s’ils devaient prévoir d’uriner après chaque coït, si chaque prémices de désir était synonyme d’angoisse ? C’est pourtant ce que des milliers de femmes vivent tous les jours. » C’est le constat des journalistes Caroline Ernesty et Agathe Moreaux, autrices de l’essai Pourquoi le sexe fait mal – Prendre enfin au sérieux la santé sexuelle des femmes paru il y a quelques jours aux éditions Hors d’atteinte. Point de départ de leur enquête ? La cystite qui touche 1 femme sur 2 au moins une fois dans leur vie, et 1 femme sur 10 au moins 4 fois par an. Une infection considérée comme non grave pourtant très douloureuse, banalisée par notre système de santé patriarcal qui laisse les femmes souffrir sans leur proposer une prise en charge rapide et efficace. Dans leur enquête, les deux journalistes dénoncent une banalisation de la souffrance des femmes et une méconnaissance criante de la médecine autour de leur santé sexuelle. Explorant tous les maux féminins (cystite, mycose, vulvodynie, endométriose, syndrome génito-urinaire de la ménopause… ), elles nous invitent à ne plus « nous faire une raison », à ne plus « vivre avec », à ne plus jamais croire que « c’est dans notre tête » et appellent la médecine et ses soignants à prendre enfin au sérieux la santé des femmes.
1 femme sur 4 n’a pas joui lors de don dernier rapport (contre 14% chez les hommes)*. En France, 35% des femmes ne sont pas satisfaites de leur vie sexuelle**.
*Selon une étude IFOP de 2019
**Selon une étude IFOP de 2021
Quelle a été le point de départ de votre enquête ?
Agathe Moreaux – Caroline et moi avions à la base le projet d’écrire sur la cystite : nous étions toutes les deux concernées et en creusant le sujet, on s’est aperçues qu’on était très loin d’être les seules. On a commencé à recueillir des témoignages en 2020 : tant de femmes étaient empêchées dans leur sexualité à cause de la cystite, infection « banalisée ». Dans un second temps, on a interviewé des soignants et lorsque nous avons échangé avec notre éditrice, il est apparu évident d’ouvrir à d’autres maladies comme la vulvodynie, l’endométriose…
Caroline Ernesty – Des milliers de femmes entendent chaque jour en consultation : « Vous savez, c’est très commun chez les femmes d’avoir des douleurs après un rapport ». Cette phrase n’a rien d’anecdotique : elle insinue que les femmes devraient se faire une raison, s’habituer à une douleur, « vivre avec ». Elle ressemble à un jugement rendu, une punition imposée à celles qui auraient décidé de vivre leur sexualité plus ou moins librement.
Les femmes ne bénéficient pas d’une sexualité aussi épanouie que la plupart des hommes du fait de l’aspect patriarcal du système dans lequel elles évoluent, au niveau de sa construction sociologique mais aussi dans son approche de la médecine.
Caroline Ernesty et Agathe Moreaux
En quoi la non prise en charge de la cystite est-elle révélatrice du traitement de la santé des femmes dans notre société ?
Caroline Ernesty – Ce qui nous a choquées, c’est la résignation de beaucoup de femmes confrontées à des cystites récurrentes. En fait, c’est hyper handicapant et ces infections récidivantes ont un impact sur le moral, l’organisation, le développement des affectes…
Chaque femme oublie ou minimise les problèmes engendrés par la cystite car à la fois elles ont intégré socialement que la souffrance fait partie inévitablement de la vie des femmes (nées pour souffrir), mais aussi car il existe une minimisation de la cystite de la part des soignants.
Caroline Ernesty
Quand la cystite n’est pas suivie de complications graves (du type pyélonéphrite), elle n’est pas prise en charge par la médecine car elle n’est pas considérée comme assez invalidante.
Agathe Moreaux – Certaines femmes nous ont confié que le sésame pour elle était de parler en consultation d’un antécédent de pyélonéphrite. Là, elles étaient écoutées et prises en charge sérieusement. L’idée n’est pas de dénigrer le travail des soignants, mais le fait de s’entendre dire que c’est normal car cela arrive à toutes les femmes, et qu’il n’y a pas grand chose à faire, c’est inacceptable.
Si c’était les hommes qui développaient très fréquemment une cystite après une relation sexuelle, il y aurait depuis longtemps des solutions durables au problème. Aujourd’hui, on ne cherche pas beaucoup à régler ce souci.
Agathe Moreaux
Dans votre livre, il est aussi question d’autres maux que la cystite et eux aussi très répandus : les mycoses récidivantes qui touchent 10 à 20% des femmes, les douleurs vulvaires, le syndrome génito-urinaire de la ménopause… Ce que vous regrettez, c’est que certaines femmes inhibent leur sexualité pendant des années ou se construisent sur un modèle de sexe douloureux…
Agathe Moreaux – C’est en effet une réalité. Ce qui nous a questionnées, c’est comment, au coeur de la médecine, on prend en charge ces douleurs. Ce que notre enquête met en lumière, c’est que non seulement la médecine est andro-centrée et connait extrêmement mal la santé des femmes, mais aussi qu’elle prendra moins bien en charge un corps non reproducteur. C’est pour cela que nous abordons les thématiques de la ménopause, mais aussi de la sexualité des femmes handicapées.
Comment expliquez-vous que beaucoup de femmes entendent encore en consultation « c’est dans votre tête » ?
Caroline Ernesty – Malheureusement les soignants ne sont pas formés ! Aujourd’hui des chercheuses et de chercheurs font avancer la médecine en expliquant par exemple que les symptômes d’un arrêt cardiaque chez les femmes sont totalement différents de ceux des hommes : sur le site de la Fédération française de cardiologie, on peut lire que « chez la femme, les symptômes d’alerte d’un infarctus du myocarde ou d’une angine de poitrine sont l’essoufflement, l’anxiété, des douleurs abdominales et/ou des nausées, une fatigue inhabituelle, des troubles du sommeil, des vertiges et des palpitations. » Ces symptômes ne sont ni connues des femmes elles-mêmes, ni des soignant.es. A consultation égale, les femmes sont moins vite et moins bien prises en charge.
Agathe Moreaux – Un livre qui nous a beaucoup porté pendant l’écriture de notre enquête est Mauvais traitements: Pourquoi les femmes sont mal soignées de Delphine Bauer et Ariane Puccini sorti en 2020 : les femmes sont absentes des essais cliniques des médicaments développés par les groupes pharmaceutiques parce que l’on craint toujours qu’elles soient enceintes ou encore que les résultats soient faussés par leurs variations hormonales. Or, dans un essai clinique, on cherche à uniformiser les profils des testeurs.
Si les symptômes observés chez les femmes ne sont pas équivalents à ceux observés chez les hommes et qu’elles ne réagissent pas comme eux aux médicaments, c’est tout un pan de la médecine qu’il faut revoir, de la pose de diagnostic au dosage des composants des médicaments en passant par leur posologie.
Agathe Moreaux
Vous évoquez le syndrome bikini ou médecine bikini. Qu’entendez-vous par là ?
Caroline Ernesty – Il faut savoir que la santé des femmes est enseignée spécifiquement à travers des spécialités qui leur sont propres comme l’obstétrique, la gynécologie ou la sénologie (spécialité médicale liée aux pathologies des seins).
Certain.es chercheurs.es parlent de « syndrome bikini » ou « médecine bikini » : la santé des femmes est réduite par la médecine à leurs organes sexuels et à leurs seins, comme s’il n’existait pas d’autres pathologies qui concernent uniquement les femmes.
Caroline Ernesty
Votre livre aborde nombre de cas spécifiques qui révèlent une médecine à deux vitesses. Vous évoquez notamment le grand tabou du syndrome méditerranéen : en quoi les femmes racisées sont encore plus exposées à une médecine lacunaire ?
Caroline Ernesty – Le syndrome méditerranéen commence à être documenté à cause d’affaires médiatisées, notamment celle de Naomi Musenga, décédée alors qu’elle avait appelé le Samu qui a refusé de la prendre en charge, niant sa douleur. Ce syndrome désignerait une forme d’exagération de la douleur des malades de culture méditerranéenne, et surtout d’Afrique du Nord et d’Afrique sub-saharienne. Les femmes racisées sont moins bien reçues dans la prise en charge de leur douleur car les soignants partent du principe qu’elles surjouent. Le syndrome méditerranéen induit que ces populations vont être moins bien soignées.
Agathe Moreaux – C’est un concept ancien qui doit remonter au début du XXème siècle et qui était enseigné en école d’infirmière jusqu’à récemment !
Le syndrome méditerranéen est ultra problématique : on lie la douleur des femmes à un aspect psychologique encore plus quand elles sont racisées, c’est la double peine.
Agathe Moreaux
Ce biais raciste est même intégré par les patientes de sorte que beaucoup d’entre elles sortent des circuits médicaux classiques car elles savent qu’elle ne vont pas bien être prise en charge ou alors elles vont chercher des médecins racisées.
Caroline Ernesty – D’ailleurs beaucoup de femmes souffrant de pathologies non prises au sérieux par la médecine classique s’organisent et se recommandent des médecins à l’écoute. Dans le cadre de nos recherches sur la vulvodynie et le vaginisme par exemple, nous sommes tombées sur le site Les clefs de Vénus qui propose un annuaire de médecins safe pour parler de ces maladie.
Autre sujet très peu évoqué aujourd’hui : la santé sexuelle des femmes handicapées qui pour rappel sont 82% à avoir été victimes de violences sexuelles. Qu’est-ce qui vous a frappées chez elles ?
Caroline Ernesty – On souhaitait parler des femmes handicapées car on voulait aborder tout un tas de cas qui ne sont pas pris en compte dans la médecine reproductive. Les femmes handicapées sont à la fois niées dans leur sexualité (pourtant elles peuvent en avoir une) et en même temps très sexualisées car elles sont plus de 82% à être victimes de violences sexuelles. C’est effrayant. Aujourd’hui se pose la question de leur consentement à la contraception ou à la stérilisation car, que leur sexualité soit voulue ou subie, elle existe.
Les lesbiennes ont-elles une sexualité plus épanouie et moins douloureuse ?
Agathe Moreaux – Au lieu d’opposer lesbiennes et hétérosexuelles, on observe un épanouissement moins important de la part des personnes bloquées dans des schémas hétéronormés, dans une logique pénétrative.
L’état des lieux de votre livre est assez sombre mais vous soulignez une évolution positive : la masturbation féminine est de plus en plus pratiquée et assumée !
3 femmes sur 4 admettent s’être déjà masturbées dans leur vie, contre 60% en 2006. 46% des Françaises admettent avoir utilisé un vibromasseur, contre 37% en 2012 et à peine 9% en 2007.
d’après une étude ifop pour le magazine ELLE en 2019
Agathe Moreaux – Les femmes reprennent en main leur sexualité et c’est effectivement positif. On peut cependant regretter que comme tous les sujets liés aux femmes, ils deviennent des opportunités de business frappés du sceau de la taxe rose. Je pense notamment à tous les sextoys qui promettent monts et merveilles aux femmes.
L’égalité revendiquée par les femmes passe avant tout par le traitement et la connaissance de leur corps.
Agathe Moreaux
Demain, c’est la Saint Valentin. Une fête (commerciale) où l’injonction au sexe est extrêmement présente. Quel message souhaiteriez-vous passer ?
Agathe Moreaux – Ne pas se faire avoir par le marketing qui joue sur la mauvaise prise en charge de la santé sexuelle des femmes, même si on sait que ce marketing est parfaitement conçu pour nous berner. Et si l’on devait vraiment acheter un petit cadeau pour la Saint Valentin, je recommanderais La charge sexuelle, Désir, plaisir, contraception, IST… encore l’affaire des femmes de Clémentine Gallot et Caroline Michel.
Caroline Ernesty – Discuter avec son partenaire sur ce qui nous fait mal et ce qui nous fait du bien est un bon message pour la Saint Valentin.
Si les femmes ont connu un renouveau dans leur sexualité, c’est parce qu’elles en ont parlé.
Caroline Ernesty
Et si on ne souhaite pas avoir de relations sexuelles à la Saint Valentin, c’est bien aussi !
Pourquoi le sexe fait mal : Prendre enfin au serieux la santé sexuelle des femmes, Caroline Ernesty, Agathe Moreaux, éditions Hors d’atteinte (19€)
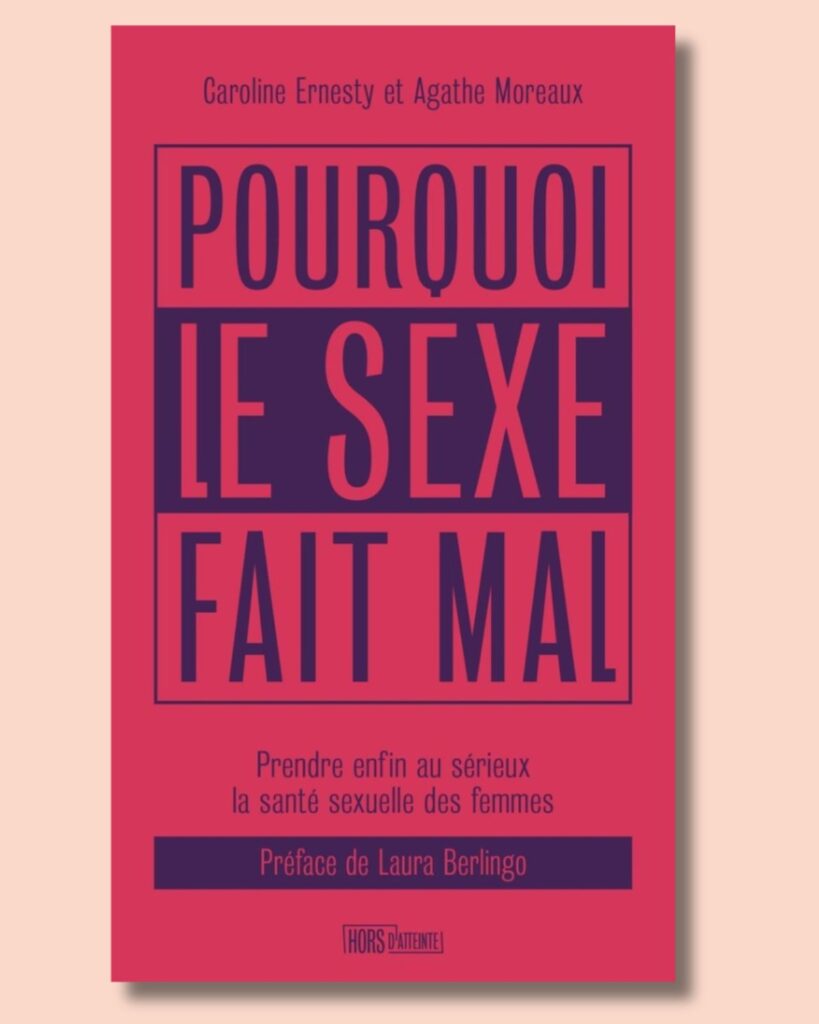
Pourquoi est-ce si fréquent et si banalisé que les femmes souffrent dans leur sexualité ?
Entre cystites, mycoses, vulvodynie et autres papillomavirus, les femmes sont confrontées à de multiples pathologies liées à la sexualité. S’y ajoutent d’autres entraves au bien-être et au plaisir féminins, comme les violences sexuelles et leurs séquelles ou la charge mentale de la contraception. Force est de constater que ces entraves sont généralement peu ou mal prises en charge. Nombre d’entre elles sont même conçues et vécues comme punitives, venant sanctionner une sexualité jugée trop libre ou trop fréquente. Le corps médical continue de reproduire en son sein de nombreuses dominations et exerce lui-même bien des violences. Pour beaucoup, il est « normal », ou en tout cas loin d’être scandaleux, que beaucoup de femmes souffrent en ayant une activité sexuelle. Pour autant, des évolutions sont à signaler. Certain·es professionnel·les de santé, organisé·es en réseaux, ou des non-professionnel·les comme des aidant·es ou des patient·es-sachant·es, cherchent des issues pour les femmes qui souffrent. Des formations existent désormais pour les médecins qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques. S’appuyant sur des témoignages de personnes malades ou qui l’ont été, mais aussi de soignant·es issu·es de nombreuses spécialités, ce livre mène une enquête, dresse un bilan et propose des solutions.